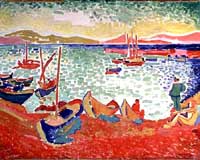Parution du roman SPASMO
Une interview de l’auteur : Patrick Micheletti
( Manuscrit.com - Mai 2003)
Pourquoi avoir écrit un roman, alors que la
spasmophilie et les troubles anxieux sont toujours abordés par des traités
médicaux ?
La première raison, c’est que je ne suis pas
médecin (j’ai abandonné en route mes études médicales), et que je n’ai aucune
prétention à me substituer à eux. Lorsque je lis les messages angoissés de
personnes décrivant leurs troubles sur les forums internet, le premier conseil que je leur donnerais,
c’est d’aller consulter un médecin, qui en le plus souvent les rassurera.
Le problème, c’est que les médecins disposent de
peu de temps pour chaque patient, alors que le spasmophile, ou l’anxieux,
a besoin d’être écouté, rassuré, compris, conseillé. Il y a beaucoup de bons
médecins, mais ce n’est pas toujours simple à gérer pour eux, je l’explique
plus en détail dan un des chapitres de mon livre (consultable sur le site)
Je n’avais donc aucune raison ni compétence pour
rédiger un traité médical de plus, il y en a déjà beaucoup, et certains excellents.
Par contre, j’ai le goût de l’écriture et de la communication, j’avais envie
de traiter ce sujet d’une manière originale, dédramatisée et positive, j’ai
donc choisi de créer des personnages, de construire une histoire, c’est devenu
un roman, qui, je l’avoue, tient aussi un peu
Vous dites avoir beaucoup travaillé avec
l'aide d'internet. Que pensez vous des forums et des chats médicaux qui se
développent actuellement sur internet, et où beaucoup
de personnes viennent chercher un soutien moral, des conseils, hors du milieu
médical, ne sachant plus à quel saint se vouer ?
Je pense que ces associations, ou ces sites web, nombreux et très fréquentés, surtout dans les pays Anglo-saxons, font un travail
utile, souvent bénévole, sincère, et de qualité. Tout n’est pas parfait bien
sûr, mais on ne peut pas demander l’impossible. Ni à un médecin, ni à un site web, ni à une association. Ils font la plupart du temps ce
qu’ils peuvent, avec des moyens limités.
La demande de soutien est pressante, de plus en
plus, et ils savent y répondre, apportant souvent une aide précieuse à la
personne en détresse, des informations, des adresses de spécialistes, un
réconfort moral immédiat, parfois la présence en ligne d’un médecin agréé, une
possibilité de rompre la solitude ou l’isolement.
Je pense donc que c’est une bonne chose, à
condition de respecter, comme sur tous les forums et les chats internet, des règles élémentaires de prudence.
Je ne peux que leur donner deux conseils :
être très prudents avec leurs interlocuteurs (qui se présentent en général sous des pseudos)
Une personne en état de crise d’angoisse ou de
détresse morale importante est particulièrement vulnérable dans la vie réelle,
mais aussi sur le web.
(Ce sujet est développé
dans un autre questions-réponses, page "articles")
Revenons à Spasmö. Quel but poursuivez vous
avec la publication de ce roman, à part devenir célèbre et gagner beaucoup
d’argent ?
Si j’avais un conseil à donner à ceux qui veulent faire fortune, je dirais que la dernière chose à faire, c’est d’écrire un roman, ou pire, un roman psychologique.
Quoique, si on écrit Harry Potter...
Trop tard...
La motivation est ailleurs. J’ai pensé que je
pouvais écrire une histoire agréable à lire, parfois amusante, parfois
informative, parfois délirante, parfois sérieuse, parfois émouvante, mais
surtout utile, je veux dire que le lecteur spasmophile ou anxieux se trouve
changé de manière positive après la lecture du livre, que son rapport au
syndrome soit modifié, qu’il se sente plus fort, plus optimiste, et mieux armé
pour se prendre lui-même en charge. J’ai voulu faire de mon bouquin un
anxiolytique puissant, dénué d’effets secondaires. Ce sont les lecteurs qui me
diront si j’ai réussi. Si c’est le cas, je demanderai que le livre soit
remboursé par la sécurité sociale.
La forme de votre récit peut surprendre… Vous
avez pratiqué ce que l’on appelle le « mélange des genres » ?
Certains passages frisent parfois la digression ou la caricature… Ne craignez
vous pas de dérouter certains lecteurs.
C’est exact. J’ai essayé de faire quelque chose
de pas banal. Puisque je décris une errance, j’ai tenté une forme de récit qui
soit un peu le reflet de ce qui se déroule dans la cervelle gentiment perturbée
de l’héroïne
Comme je le disais, j’ai voulu traiter le sujet
de manière originale.
Mêler roman et médical, ce n’est déjà pas
simple, mais le récit passe aussi sans prévenir du traité médical à l’essai
sociologique, de la virée entre copines à la pièce de théâtre, du récit
mythologique au petit manuel de philosophie, du documentaire historique au
guide touristique, du pastiche au pamphlet anti-charlatans, de l’histoire
d’amour au conte de fées… Le tout
agrémenté de digressions multiples, de retours en arrière, de fausses pistes,
de passages du rire aux larmes, et de basculements entre réel et imaginaire. Il
y a même une recette de cuisine à haute vertu symbolique… Je suis conscient du
fait que cela peut dérouter, voire même agacer, mais en tout cas, ça ne laisse
pas indifférent. Il y a là-dedans une bonne part de jeu avec le lecteur, à
condition que celui-ci accepte d’entrer dans le jeu sans à-priori.
Le fait que ce récit ne se prenne pas au sérieux
ne m’a pas empêché de traiter les sujets abordés avec une grande rigueur et une
documentation importante.
C’est le cas
pour le volet « médical » du texte (anxiété, phobies, attaques
de panique et cauchemars), qui est très rigoureux techniquement parlant, tout
en restant, je l’espère, sans prétention, agréable à lire, digeste, et
édifiant.
Je l’ai traité un peu comme une enquête
journalistique, en poussant le vice jusqu’à me rendre moi-même aux
consultations de généralistes ou de spécialistes de la chose (
les bons et les moins bons…)
Il semble aussi que vous ayez du goût pour le
pastiche…
J’ai pris un réel plaisir à pasticher, au fil des pages Christian Signol, Molière, Christine Angot,
Umberto Eco, Comte-Sponville, Audiard,
Hubert Reeves, Cavanna, je ne sais plus…
Le récit dans son ensemble ressemble à un voyage
initiatique. Est-ce une volonté de votre part ?
Oui. J’ai essayé de raconter un voyage
initiatique, des premiers troubles jusqu’à la guérison, à travers un syndrome
anxieux qui peut être vécu péniblement, mais en racontant d’une manière
non-pénible, c’est à dire en réalisant un roman débridé, amusant, tonique,
impertinent, émouvant, aussi, j’espère, mais surtout résolument optimiste.
L’itinéraire en question va entraîner le
personnage dans des rencontres et des périples aléatoires, de l’hôpital Georges
Pompidou à la piscine de la butte au cailles ou au supermarché chinois des
frères Tang, dans le treizième, puis au parc Montsouris, en passant par les fermes de haute-corrèze,
les rêves fauves ou pointillistes, les satellites de Mars, l’exécution de
Marie-Antoinette, les marécages où sévit l’Hydre de Lerne, la finale du mondial
1998, le salon de la voyance, la descente en canoë des gorges de la Dordogne,
le cloître du prieuré de Carennac, l’accident de Lady
Diana, la rencontre avec Victor Hugo dans un
labyrinthe de maïs, les grottes de Lacave, le port de
Collioure, les cap-horniers, l’île de la Grande-Jatte, les ferry-boats de
Marseille, les crêperies de Montparnasse…
Mais où est don le lien entre tout cela ?
Je me le demande moi-même parfois, la nuit…
Non, sans rire, le lien, c’est l’eau. L’eau qui
est, paraît-il, le symbole universel des émotions. L’eau qui est présente tout
au long du récit, parfois très discrètement, de la pluie qui tombe sur les
bouchons de la nationale 7, jusqu’aux geysers islandais, à la fin.
L’eau et le labyrinthe. Un labyrinthe intérieur,
où chacun va trouver son propre chemin.
J’ai utilisé plusieurs fois des thèmes
mythiques, en m’inspirant de cette phrase de Pascal Quignard :
« Pour faire affleurer l’originaire, il faut aller à la source. Ce sont
les rêves, puis les mythes, qui ont créé les premières séquences d’images
capables de faire ressentir les expériences fondamentales. »
J’ai aussi utilisé les décors de la rivière (La
Dordogne) et du labyrinthe, qui reviennent souvent dans les récits initiatiques.
Le labyrinthe que je décris aux chapitres 22 et 23 existe vraiment, à Creysse,
sur les bords de la Dordogne. C’est le parc Labyrinthus.
D’ailleurs, tous les lieux décrits dans le livre sont des lieux réels, on
peut, si on veut, en voir des photos sur un de mes sites web :
http://argentat.free.fr
Toute la seconde partie du roman se déroule en Corrèze et dans la vallée de la Dordogne. Pourquoi avoir choisi ce décor ?
J'avais
besoin d'une belle rivière, de canoës, de méandres, de
labyrinthes, de cloîtres, de cavernes, de contes et de légendes,
de silence et de paix intérieure. Tout y était. La vallée
de la Dordogne est de plus en plus belle chaque année. C'est devenu
une sorte de "niche" écologique magnifiquement préservée.
Une des plus belles rivières du monde. Une des plus chargées
d'Histoire. Un patrimoine de mille châteaux.
Des dizaines de milliers de touristes viennent chaque année du monde
entier pour savourer cette fameuse descente en canoë. Ceux qui viennent
une fois reviennent toujours.
Descendre cette rivière, c'est une peu comme faire un voyage dans le temps, à travers toutes les époques, jusqu'à la préhistoire. C'est d'ailleurs dans ce décor idéal que Michaël Crichton (Jurrasic Park) a situé l'action d'un de ses derniers romans : "Prisonniers du temps" . Une histoire de voyage dans le temps, forcément...
Est-ce qu'il y a un rapport avec les littératures de l "Ecole de Brive" ?
Un rapport
géographique évident, un rapport sentimental aussi. Beaucoup
de récits se déroulent dans la basse vallée, comme
ceux de Signol, par exemple, moi, je m'intéresse plus aux flots
tumultueux, aux collines inquiétantes, aux forêts englouties,
aux villages fantômes, aux torrents disparus...
Signol, Bordes,
Michelet, Peyramaure,
ils ont bercé quelques unes de mes longues soirées d'hiver en
Corrèze... Mais le rapport de cette école avec moi, c'est un
peu le rapport qu'il y a entre "école" et "école
buissonnière"...
L' "école buissonnière de Brive", tiens, pourquoi pas... Je vais mettre un panneau comme ça sur mon stand à la prochaine Foire du Livre Briviste. Je suis sûr qu'ils vont être ravis...
Vous utilisez également cette notion de « guide »,
ou de personnages imaginaires, comme la fée, le troll, ou même Karine, qui
garde jusqu’au bout son mystère…
J'ai peut-être trop lu Tolkien...
Les spasmophiles et les sujets anxieux ont souvent l’impression d’être enfermés
dans un labyrinthe étouffant. Ils veulent atteindre la sortie, mais pour cela,
ils doivent d’abord trouver le guide et le chemin. En parcourant le chemin,
souvent semé d’embûches, ils apprendront à se connaître eux-mêmes, à se prendre
en charge, et à vaincre leurs démons intérieurs. Geneviève Goreux-Marois
l’explique très bien sur la page d’accueil de son association, quand elle
dit que le spasmophile doit devenir « lui même l’artisan de sa guérison »
C’est valable pour les spasmophiles, mais d’une manière générale pour les
anxieux, les angoissés, et les phobiques.
Ceux qui vaincront le labyrinthe en sortiront différents,
plus forts et plus sereins. Ils apprendront à se connaître eux-mêmes.
C’est ça le voyage initiatique.
Selon vous, c’est quoi la spasmophilie ?
Il y a débat depuis plus de trente ans
là-dessus, débat parfois très animé, voire fougueux, y compris entre les
médecins, qui ont parfois des avis diamétralement opposés sur le sujet, ce qui
désoriente le patient, et souvent le fait venir sur ces forums dont je parlais
plus haut, pour solliciter des avis et des conseils qui eux aussi, souvent vont
être contradictoires…
Le débat entre les médecins est loin d’être
clos, alors entre les non-médecins et ceux qui
croient avoir tout compris, je vous dis pas les prises
de bec (et de tête…) à n’en plus finir…
Pas simple…
Je le définis dans mon livre, et la plupart des
traités médicaux sont d’accord maintenant sur la définition, même si certains
rejettent le mot « spasmophilie », pour le remplacer par un autre qui
recouvre les mêmes symptômes. La définition donnée par Geneviève Goreux-Marois, qui fait un effort louable de simplification,
me paraît claire : « Une hypersensibilité neuromusculaire et affective »
Mais encore…
Cet état de l’organisme et du
système nerveux peut produire une panoplie de symptômes très variables d’une
personne à l’autre (un syndrome), à la fois physiologiques et psychologiques,
souvent étroitement liés, dans une alchimie très complexe, ce qui donne au
syndrome ce caractère insaisissable, qui fait qu’on l’appelle parfois « la
maladie invisible »
Il y a des millions de spasmophiles
(ou équivalent) dans le monde, mais je suis certain qu’il n’y en a pas deux
identiques. Il y a tout de même un tronc commun de symptômes facilement
identifiables, et ce fameux signe de Chvostek, que
les médecins adorent, qui serait presque un signe de ralliement…
Est-ce une maladie ?
Non. Définitivement. Tous les spécialistes
sont d’accord là dessus, et je l’explique, moi aussi, dans mon livre. C’est
seulement un syndrome, c’est à dire une panoplie de symptômes. Le seul danger,
c’est de laisser s’installer cet état, pour dériver ensuite vers de véritables
maladies, comme la dépression, ou d’autres maladies organiques liées au stress.
(voir au chapitre 6 de SPASMO)
Vous expliquez dans votre livre,
curieusement, que cette hypersensibilité peut être un handicap, mais aussi une
chance…
J’en suis convaincu. Les hypersensibles ressentent
plus fortement tous ces petits troubles qui leur empoisonnent la vie. Ils
ressentent plus fortement la douleur, mais aussi plus fortement le plaisir.
Ils sont plus créatifs, plus intuitifs, bref, plus sensibles… De nombreux
artistes ou créatifs sont ou ont été spasmophiles. Proust est un exemple célèbre… Très peu l’avouent,
par peur du regard des autres, par crainte d’être catalogué « faible »
ou « looser », dans un monde ou il faut absolument être « fort »
et « battant », toujours avoir la pêche, le peps, le sourire aux
lèvres et les canines qui rayent le plancher. Avouer ses faiblesses, c’est
dévalorisant, même devant un médecin, c’est pourquoi de plus en plus de personnes
le font sur les forums internet, et sous le couvert
de l’anonymat.
Pour ce qui me concerne, je conseille de dédramatiser,
mais aussi de relativiser. Je connais des gens qui ont des problèmes de santé
beaucoup plus sévères .
Vous décrivez des crises de panique avec un réalisme
saisissant, particulièrement une survenue au personnage de Karine dans
un supermarché chinois du treizième arrondissement.
La sensation de mort imminente, souvent décrite
par les spasmophiles, est à son paroxysme dans ces crises. Le choix du supermarché
n’est pas anodin. Les spasmophiles ont souvent des problèmes dans les lieux
publics, rue, supermarché, restaurants, cinémas… La peur du malaise en public,
avec la crainte de paraître ridicule, tout cela augmente la charge anxieuse,
et nourrit le cercle vicieux de l’attaque de panique. La plupart du temps,
la crise cesse quand ils quittent le lieu public en question. La description
de ce mécanisme est un des éléments qui permettent au médecin d’effectuer
le diagnostic.
Vous mettez en scène à plusieurs reprises l’environnement social des personnages, ainsi
que leurs rapports amicaux, amoureux, ou les relations avec les parents. Quel
lien cela a-t-il avec la spasmophilie ?
J’ai voulu élargir la réflexion, au-delà du
syndrome spasmophile, vers les processus socioculturels générateurs de
l’anxiété et des troubles associés (panique, phobies, cauchemars, insomnies…)
L’environnement social et l’intégration plus ou moins bonne du sujet dans cet
environnement est une condition essentielle de l’évolution de son état. Le
sentiment d’être isolé, incompris, ou pas dans la norme accentue la dégradation
de l’état. Par contre, les bonnes rencontres au bon moment, les nouveaux amis,
de bons rapports avec sa famille, un travail gratifiant, l’amour, les enfants,
tout cela accentue l’amélioration de l’état.
Dans un magazine
de psychologie récent, celui de janvier 2003 je crois, Isabelle Adjani
constatait avec amertume que « l’amour ne guérit pas… » Peut-être…
mais je dirais que s’il ne guérit pas, c’est tout de même un sacré bon médicament…
Au moins aussi bon que le Seropram ou le Lexomil…
Vous décrivez vers la fin du roman la rencontre
de l’héroïne avec une sorte de médecin idéal que tout le monde rêverait de
rencontrer… Ce médecin existe-t-il ?
Non. Je ne crois pas que le médecin idéal existe. J’aimerais juste qu’il soit comme cela. Après tout, il existe peut-être… Si quelqu’un le connaît, qu’il me donne son telephone…
C'aurait pu être quelqu'un ressemblant au
sympatoche docteur Christophe André,
Pour moi, soigner les troubles physiologiques liés au syndrome, en
particulier via les médecines douces et une hygiène de vie assez
rigoureuse, mais finalement bénéfique, me semble indispensable,
en association, bien entendu, avec la psychothérapie, ou un traitement
allopathique, lorsque le médecin le juge nécéssaire.
Beaucoup de spasmophiles s’épuisent en errant
vainement à la recherche de ce médecin idéal ou du remède miracle. Il y a
beaucoup d’excellents médecins qui savent écouter, comprendre, et soigner, mais
il ne faut pas leur demander l’impossible, il faut aussi apprendre à se prendre
soi-même en charge.
Vous semblez particulièrement remonté
contre les charlatans, les soi-disant « guérisseurs »
Je déteste les gens qui profitent de la faiblesse
ou de la naïveté des autres pour leur soutirer de l’argent ou pour profiter
de leur vulnérabilité. Je me bats depuis toujours, avec d'autres, contre les
sectes, les voyants, les parapsy débiles, les guérisseurs
et les gourous prétentieux en tout genres. Ils sont nombreux, mais
nous aussi... Tous ces parasites qui font commerce de la crédulité humaine,
et qui isolent encore plus leurs victimes et les entretiennent dans la dépendance
pour mieux en profiter. Les spasmophiles, et les gens qui souffrent d’angoisses,
d’anxiété, ou de dépression, sont souvent fragilisés, ils se sentent isolés,
appellent au secours, recherchent une écoute désespérément, quitte à payer
le prix fort. Les escrocs le savent, et ils en profitent un maximum, je trouve
cela méprisable.
Est-ce qu’il existe d’autres romans mettant en
scène des personnages spasmophiles ?
Pas à ma connaissance… La Spasmophilie a été
assez peu évoquée jusqu’à maintenant dans la littérature ou le cinéma.
Néanmoins, cela a été fait, toujours sur le ton
de la comédie, dans « On
connaît la chanson » de Resnais ou dans « Tanguy »,
de Chatiliez (tous deux de gros succès), mais à
ma connaissance, il n’a jamais été publié de roman ayant un spasmophile pour
personnage principal et la spasmophilie pour thème central.
( J’ai
bien cherché…) Il s’agit donc d’une grande première dans l’histoire de la
littérature de langue Française…
Par contre, il est paru ces dernières années de
très nombreux ouvrages médicaux, ou se prétendant tels, sur ce sujet et ses
variantes. Un des derniers en date étant « Petites angoisses et grosses
phobies », au Seuil, excellent, à
quelques détails près, rédigé ( et illustré ! ) sur un ton, là aussi, résolument humoristique
et décrispé. En fait, je crois que c’est la meilleure manière d’aborder le
sujet, et que les films ou les livres visant à dédramatiser la chose sont
une excellente thérapie pour les personnes qui souffrent d’anxiété ou d’hyperémotivité.
Où avez-vous trouvé l’inspiration pour les
personnages imaginaires ou certaines scènes de cauchemar ou d’hypnose ?
Quelques personnages ou créatures du récit sont
empruntés aux contes de fées du Limousin, d’autres aux légendes scandinaves,
comme les Trolls.
Les scènes servant à illustrer certains cauchemars
ou états hypnotiques sont inspirées de tableaux de Seurat (La
grande jatte, Une baignade à Asnières)
ou de
Derain (Le port de Collioure)
En dehors de ce roman, quels sont vos projets d'écriture,
vos activités où vos autres centres d’intérêt ?
Je travaille dans la branche support systèmes
d'information d'une grande compagnie aérienne française. Je
travaille beaucoup avec internet, depuis très longtemps, et je gère plusieurs
sites sur des sujets variés allant de la littérature au sport,
à l'astronomie, aux voyages, ou à la photo. J’ai
une fille de treize ans, je pratique le golf, J’ai beaucoup voyagé
plus jeune, et je continue…
J’écris dans des magazines, des articles ou des chroniques, j’écris aussi
des textes et des nouvelles de science-fiction ou des récits fantastiques.
Je suis en cours de documentation pour un pojet de roman du terroir atypique,
plus proche de Cavanna que de la dernière trilogie de Signol, disons
"école buissonnière de Brive", qui racontera les années
d'apprentissage de la rivière et de la vie d'un des derniers gabariers-bûcherons
de la haute vallée de la Dordogne, juste
avant la construction des barrages.
Ce récit ne fera pas dans la dentelle, ni dans le lyrisme régional
ou bucolique. Il sera à l'image des ces hommes et de la Dordogne du
début du siècle, en amont d'Argentat, rude, tumultueux, imprévisible,
fort en gueule, et même si nécéssaire abracadabrantesque
!
Les travaux préparatoires de documentation sont en cours. Il reste
très peu de documents écrits. Beaucoup de souvenirs de la haute-vallée
ont été engloutis par les lacs de barrages, avec les fermes
et les villages.
La plupart des témoignages sur cette époque passant par la tradition
orale, il faut d'abord écouter ceux qui pépétuent cette
tradition. Ils sont hélas bien peu nombreux maintenant...
Votre livre est-il disponible en
librairie ?
On peut acheter la version papier sur Manuscrit.com.
mais il se vend surtout maintenant sur
le Kindle d'Amazon en version numérique (moins de 1 euro)
http://www.amazon.fr/gp/product/B00JU6HEDG?*Version*=1&*entries*=0
Au fait, le personnage principal de votre roman
s’appelle Isabelle… Est-ce que cela a un
rapport avec Adjani ?
Pas du tout. C’est juste un prénom que j’aime
bien. Par contre, le personnage d’Isabelle qui a inspiré le récit, existe
réellement, et cette histoire est en grande partie une histoire vraie. C’est un
témoignage, un long travail d’enquête et de réflexion mené sur plusieurs
années, j’espère qu’il sera utile.
Merci pour cette interview, qui éclaire bien des
aspects de votre roman.l
Merci à vous d’avoir accepté de la diffuser. Je
pense qu’elle est indispensable pour bien comprendre le livre.
A bientôt.